KING
.. ET ... LA ...GUERRE... DU . VIETNAM 2
l'utilisation
littéraire du Vietnam.
"Si j'ai
délibérément évité d'écrire
un roman se passant dans les années 60,
c'est parce
que cette époque me paraît aujourd'hui infiniment
lointaine,
comme si
quelqu'un d'autre l'avait vécue." (Anatomie de
l'horreur, 187)
Nous avons vu dans la première
partie que les allusions au Vietnam sont fréquentes
jusqu'à la période allant jusqu'aux Tommyknockers. Elles sont apparu de moins en moins
nombreuses, alors qu'elles sont très courantes dans les
oeuvres jusque Simetierre.
Ensuite elles disparaissent complètement pendant dix ans, pour
réapparaître avec Désolation, en 1996, où elles prennent une place
importante, avec l'écrivain Marinville, qui est allé au
Vietnam, et dont la rédemption est liée au poste de
guet Vietcong, lieu d'un jeu du jeune David. Enfin plus
récemment, le Vietnam concerne trois des cinq textes de
Coeurs perdus en
Atlantide. Il semble ainsi que
les notations concernant le Vietnam ont été abondantes
dans l'oeuvre de King tant que le
conflit était récent, pour être
délaissées quand le souvenir s'en est estompé
dans les esprits. Le Vietnam réapparaît maintenant avec
l'âge de la maturité et le retour sur les souvenirs des
années soixante, années de jeunesse de King.
Surtout, à l'imitation de Straub, le
Vietnam devient l'objet d'une exploitation littéraire.
 .. du site ..
.. du site ..
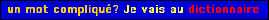
 ..
..  Le poste de
guet vietcong.
Le poste de
guet vietcong.
Si tous les écrivains de
King n'ont pas fait la guerre, plusieurs en sont revenus
avec des souvenirs : Jimmy dans Salem, Gaston
Lachance, dans Le
corps, Marinville dans
Désolation. Gaston Lachance, un des doubles de King, a
gardé de son enfance un souvenir qu'il a traîné
jusqu'au Vietnam : "Le
meilleur moment de cette équipée, le plus pur, un
moment où je me suis vu revenir, presque sans le vouloir,
chaque fois qu'il y a eu un malheur - mon premier jour dans la
brousse, au Vietnam, quand ce type est entré dans la
clairière où nous étions, une main sur le nez,
et quand il a enlevé sa main il n'y avait plus de nez, il
avait été emporté par une
balle." (407).
Cette référence, liée à la peur, n'allait
pas bien loin.
L'écrivain et la mort de Dieu.
Métaphysiques et fondamentales
par contre seront les questions qui vont se poser dans Désolation à Marinville. Déjà
Johnny, pessimiste dans L'Accident,
voyait ironiquement les choses aller mal de la faute d'un Dieu pour
le moins partial : "Un monde
ordonné et dirigé par un Dieu de tout premier ordre. Il
devait être du côté du Vietnam, parce que c'est de
cette manière catastrophique qu'il mène les choses
depuis le commencement des temps." 27 (194). Marinville est plus radical :
"Quant à Dieu, en ce
qui me concerne, il est mort au Vietnam en 1969. Jimi Hendrix jouait
"Purple Haze" sur la radio des forces armées, à ce
moment-là."
(Désolation, 434) Le roman est en grande partie
organisé autour de la non-mort de Dieu, et du rachat religieux
de Marinville, qui se sacrifiera après avoir mené une
vie qu'il juge inutile et à laquelle il essaie de donner un
sens.
Marinville a écrit plusieurs
romans, qui ont eu un succès déclinant, et il effectue
sur les conseils de son ex-épouse un voyage en moto qui sera
un prétexte à recycler des articles écrits il y
a longtemps et qui ont eu à l'époque du succès.
Il est étonné de rencontrer sur sa route un flic
lettré qui le reconnaît : "«C'est bien vous, n'est-ce pas? C'est vous qui avez
écrit Ravissement! Et, oh merde! Le Chant du marteau. Me
voilà face au type qui a écrit Le Chant du
marteau! (...)
Ça alors! disait le
flic. Vous êtes un de mes auteurs
préférés. Vous vous rendez compte! Le Chant du
marteau... Je sais que les critiques n'ont pas aimé, mais
qu'est-ce qu'ils y connaissent? 28 (...)
Le Chant du marteau est le
meilleur livre sur le Vietnam que j'aie jamais lu. Il renvoie aux
oubliettes Tim O'Brien, Robert Stone...»" (80) Marinville n'a
pas été combattant, mais reporter, il a pris des
risques : "Elle parlait avec
un calme qui n'était pas étranger à Johnny. Il
l'avait connu [ce
calme] au Vietnam,
après une demi-douzaine de combats. Il l'avait connu en tant
que non-combattant, bien sûr, carnet de notes dans une main,
stylo dans l'autre, magnétophone Uher à l'épaule
orné du symbole de la paix." (336)
Il faut mettre en évidence une
particularité que l'on retrouvera quand sera
étudiée l'oeuvre de Straub
consacrée au Vietnam, la place de la musique dans la vie
là-bas mêlée aux souvenirs qui en ont
été ramenés : "Johnny savait de quoi elle parlait. Il l'avait vu.
Curieusement, il lui sembla même qu'il avait vu tout ce qu'elle
racontait - en rêve, dans une autre vie.
C'est seulement ce vieux kosmic blues du Vietnam qui revient, se
dit-il. La façon dont elle avait décrit le flic lui
rappelait certains soldats complètement imbibés avec
lesquels il s'était trouvé parfois, et les histoires
qu'on racontait à voix basse tard le soir - des récits
de types qui avaient vu des types, leurs propres copains, faire des
choses terribles, inavouables, avec cette même expression de
joie immaculée sur le visage. C'est le Vietnam, c'est tout,
qui te revient comme sous l'effet de la drogue. Il ne te manque plus,
maintenant, pour refermer la boucle, qu'un poste à transistors
jouant «People are Strange» ou «Pictures of Matchstick
Men».
On trouve dans Désolation un curieux paragraphe où King
porte un jugement sur Coeurs perdus en Atlantide qu'il n'écrira que plus tard, alors qu'il aura le
même comportement littéraire que Marinville :
"Il sentait qu'il se passait
autre chose ici, quelque chose qui n'avait que peu ou rien à
voir avec les souvenirs dérisoires d'un romancier qui
s'était nourri de la guerre comme un busard d'une charogne...
et avait écrit dans la foulée exactement le genre de
mauvais livre qu'un tel comportement entraîne à coup
sûr." (341/2) Il
est vrai que même dans Coeurs perdus en Atlantide,
King s'est gardé alors d'écrire un livre sur
la guerre du Vietnam elle-même, pour se cantonner à ses
conséquences sur les vétérans dans la vie civile
des années plus tard.
David le
prophète.
Avant d'en revenir à
Marinville, il faut faire un détour par David, sorte de
prophète et d'intermédiaire de Dieu dans ce roman, et
son poste de guet, qui servira de pont entre lui et Marinville. Le
flic n'est qu'un des avatars de Tak, entité maléfique
qui vit enfermé dans un puits de mine et qui a
été malencontreusement libéré. Dieu veut
la disparition de ce rival et se servira de David. David a 11 ans, et
un bon copain, Brian, qui vient d'être renversé par une
voiture. David éprouve l'impérieuse
nécessité d'aller dans la clairière d'un bois,
où, avec son copain, il a édifié une plate forme
sur un arbre : "Un sentier -
étroit, mais praticable à bicyclette à condition
de se mettre en file indienne - montait à cette
clairière. C'était là, dans le Poste de guet
vietcong, que les garçons avaient essayé une des
cigarettes de Debbie Ross l'année précédente et
avaient trouvé cela horrible, là qu'ils avaient
feuilleté leur premier exemplaire de Penthouse (Brian l'avait
trouvé sur le dessus d'une corbeille à papiers à
l'arrêt du bus 24, au pied de la colline), là qu'ils
avaient tenu leurs plus longues conversations et rêvé
leurs plus beaux rêves. (...) C'était là, dans la clairière qu'on
atteignait par la piste Hô Chi Minh, que les garçons
avaient le plus profité de leur amitié, et
c'était là que David sentait soudain qu'il devait se
rendre." (149/150)
La piste Hô Chi Minh n'est pas leur propriété
exclusive et d'autres enfants viennent y jouer habituellement.
Personne ne s'y trouve aujourd'hui alors que David s'y sent
attendu.
Monté sur la plate-forme, il
éprouve un grand trouble et se met à pleurer :
"Pourquoi suis-je ici?
Pas de réponse.
Pourquoi suis-je venu? Est-ce que quelque chose m'a fait venir?
Pas de réponse."
Aucune réponse pendant longtemps. Dieu aime se faire
attendre... Puis une voix dans la tête de David, qui n'est pas
la sienne : "«Oui, avait
dit cette voix. Je suis là.
- Qui êtes-vous ?
- Qui je suis»
29, dit la voix
avant de se taire comme si cela expliquait tout." (152) David,
impressionné par la voix qui dit encore quelques phrases, se
décide à faire une prière : "«Qu'il aille mieux, dit-il. Dieu, fais
qu'il guérisse. Si tu le fais, je ferai quelque chose pour
toi. J'écouterai ce que tu veux et ensuite je le ferai. Je le
promets.» (...)
La voix lui reparla. David
écouta, la tête inclinée, se tenant toujours
à la branche, sentant toujours des fourmillements dans ses
membres. Puis il hocha la tête. Ils avaient planté trois
clous dans le tronc de l'arbre." (153)
Il explique son attitude à
Marinville, l'incrédule : "«C'est ça, la prière, c'est parler
à Dieu. Au début on a l'impression de se parler
à soi-même, mais après, ça
change. (...)
- Et est-ce que Dieu te
répond?
- Il arrive que je croie l'entendre, dit David. (...)
Et une fois, je sais que c'était lui. (...)
Sur la plate-forme que Brian et moi avons construite dans un arbre,
j'ai demandé à Dieu de le guérir. J'ai dit que
s'il le faisait, je lui donnerais une reconnaissance de dette.
(...) Quand je me suis levé pour redescendre
de l'arbre, Dieu m'a dit de laisser mon autorisation de sortie
à un clou qui sortait de l'écorce, là-haut.
C'était comme s'il voulait que je la rapporte, mais à
lui au lieu de Mme Hardy, au secrétariat." (164)
Cet événement s'est passé avant que David
rencontre Marinville, qui veut quitter le guêpier de
Désolation et abandonner la lutte contre Tak, ce que lui
reproche son assistant Steve : "Je n'ai lu aucun de tes livres, mais j'ai lu cette
nouvelle que tu m'as donnée, et j'ai lu ce livre sur toi, dit
Steve, celui du professeur dans l'Oklahoma. Je crois que tu as
été un sacré fouteur de merde, un poison pour
tes femmes, mais tu es allé au Vietnam sans armes, pour
l'amour de Dieu... et cette nuit... le couguar... que reste-t-il de
tout ça?" (470) Cet
appel à son courage reste sans écho.
Entre temps, Marinville a perdu son
portefeuille avec des photos, que retrouve David : "Il ne quittait pas la photo des yeux. Elle
montrait trois hommes devant un baraquement de fortune - un bar
à en juger par la publicité pour Budweiser à la
fenêtre. Le trottoir grouillait d'Asiatiques. (...)
L'homme du milieu portait un
jean et un T-shirt gris. Une casquette de base-ball des Yankees
était repoussée sur l'arrière de son
crâne. Une sangle lui barrait la poitrine. Quelque chose de
gros pendait sur sa hanche.
«Sa radio, murmura David en touchant l'objet.
- Non, dit Steve après avoir regardé. C'est un
magnétophone comme il y en avait en 1968.
- Quand je l'ai rencontré au pays des morts, c'était
une radio.» (...)
Au-dessus de sa tête,
sur le linteau de la porte du bar dont apparemment ils venaient de
sortir, une pancarte peinte à la main indiquait le nom du lieu
: LE POSTE DE GUET
VIETCONG." (472) L'homme que précisément David a
vu en rêve sur sa plate forme, avatar de Dieu, qui lui a
longuement parlé de sa mission et de sa cruauté : un
jeune homme mince, casquette de base-ball des Yankees, poste en
bandoulière et tous détails concordants, y compris
l'appareil qui jouait un air de Spencer Davis Group, avec Steve
Winwood : "Better take it
easy, cause the place is on fire."
Quand David revoit Marinville,
celui-ci porte à la main un marteau, le titre de son roman sur
le Vietnam - il faut de l'attention pour établir ce rapport -
et qui servira de manière décisive à
l'emprisonnement de Tak. Il lui montre la photo : "«C'est le gars de taille moyenne au
milieu qui m'intéresse».
Tout à coup, tout au fond de lui, Johnny sait où
l'enfant voulait en venir, ce qu'il allait dire, et tout au fond de
lui, il gémit.
- «Le type en T-shirt gris et casquette des Yankees, continua
David. Le type qui m'a montré le Puits Chinois de mon Poste de
guet vietcong. Ce type, c'était vous.
- Foutaises ! Le même genre de connerie que tu débites
depuis... »
Doucement, sans fausse note, tendant toujours le portefeuille d'une
main, David Carver chanta :
«Well I feel so good, everybody's gettin' high...»
Ce fut comme si Johnny avait reçu un coup en pleine poitrine.
Le marteau lui tomba des mains.
«Arrête, murmura-t-il.
- ... Better take it easy, cause the place is on fire...
- Arrête!» cria Johnny.(...) Il
sentait quelque chose qui commençait à bouger à
l'intérieur de lui. Quelque chose de terrible. Qui glissait.
Comme une avalanche. Pourquoi avait-il fallu que ce gamin vienne?
Parce qu'il avait été envoyé, bien sûr. Ce
n'était pas la faute de David. La véritable question
était de savoir pourquoi le terrible maître de l'enfant
ne voulait pas qu'il parte.
«Le Spencer Davis Group, dit David. C'est Steve Winwood qui
chante. Vraiment chouette.»" (502)
Marinville se trouve en pleine confusion : "Il se divisait littéralement en deux. Il y avait
le John Edward Marinville qui ne croyait pas en Dieu et ne voulait
pas que Dieu croie en lui. (...) Et il y
avait Johnny qui voulait rester. Plus encore : qui voulait se battre.
Qui avait progressé assez loin dans cette folie surnaturelle
pour vouloir mourir dans le Dieu de David." (504/505).
Marinville fait son choix, se dévoue et enferme Tak dans son
ini avec cartouche de dynamite qu'il percute avec le marteau,
périssant dans l'explosion.
Tak est enfermé à
nouveau dans son puits. David trouve un papier dans sa poche et se
met à pleurer : "«Qu'est-ce que c'était? demanda Mary.
Qu'as-tu trouvé?»
Elle tendit la main vers le papier bleu froissé, mais David ne
le lâcha pas.
(...)
- C'est une autorisation de
sortie de mon collège, dans l'Ohio. L'automne dernier, je l'ai
accrochée à un clou dans un arbre, et je l'y ai
laissée.
- Dans un arbre. En Ohio. L'automne dernier..., dit-elle en le
regardant d'un air pensif. En automne!
- Oui Alors je ne sais pas d'où il la tient... et je ne sais
pas où il la gardait." (570)
On remarquera, et cette idée sera reprise dans la conclusion,
que dans le récit le Vietnam est utilisé dans une autre
intention que d'en faire le fond du débat.
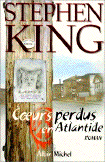 Des
étudiants hostiles aux vétérans
blasés.
Des
étudiants hostiles aux vétérans
blasés.
Dans Désolation, le Vietnam a été utilisé
littérairement, et les descriptions concernant la guerre
n'étaient que des incidences. Dans trois des cinq nouvelles de
Coeurs perdus en
Atlantide, le Vietnam tient une
présence déterminante. Dans cette novella, des
étudiants prennent conscience de la guerre et des troubles
sociaux et moraux qu'elle suscite. Dans Willie l'aveugle et Pourquoi nous étions au Vietnam, deux nouvelles, des années
après la guerre, des vétérans réagissent
à leur manière aux conséquences profondes sur
leur comportement causées par cette guerre qui les a
profondément troublés ou minés.
Sauf pour mettre en scène des enfants, King n'a pas
utilisé la période historique de la seconde partie des
années soixante, pendant lesquelles se déroulait la
guerre du Vietnam, et n'a pratiquement pas évoqué ses
années d'université (une seule nouvelle en parle
brièvement, La révolte de Caïn, sur le thème de la tuerie collective qui a
fasciné King pendant ses jeunes années). Il le signale
dans Anatomie de
l'horreur : "Si j'ai délibérément
évité d'écrire un roman se passant dans les
années 60, c'est parce que cette époque me paraît
aujourd'hui infiniment lointaine, comme si quelqu'un d'autre l'avait
vécue." (187)
C'est dire avec quel intérêt le lecteur attendait ce
recueil, dont il savait qu'il comportait un long développement
sur la vie d'étudiant de King à l'université du
Maine (1966/70), et des considérations adultes sur le
Vietnam.
Les trois récits qui
concernent le Vietnam se passent à des périodes
différentes. La cohérence du recueil est assurée
par la présence, dans chacun des segments, de relations avec
un épisode qui s'est produit entre plusieurs adolescents,
l'agression brutale d'une fillette par quelques voyous qui a
durablement marqué aussi bien les agressés que les
agresseurs. Les situations conflictuelles du roman découleront
de cette agression. Certains de ces personnages
réapparaissent, devenus étudiants ou adultes, toujours
marqués dans leur comportement par ce vécu enfantin. Ce
lien servira de fil conducteur, et nous permettra de suivre la vie de
ces préadolescents devenus des hommes. Les
événements d'Indochine ne feront que donner des
orientations à ce drame enfantin vraiment marquant, alors
qu'il est courant dans le monde de l'enfance, et pour tout dire,
assez insignifiant.
La prise de
conscience en 1966 (Chasse-coeurs en
Atlantide).

King reprendra plusieurs fois la
constatation déjà rencontrée dans Anatomie de l'horreur
à propos des changements
dans le mode de vie américain :"Je doute qu'il y en ait jamais eu d'une ampleur
comparable à ceux que connurent les étudiants qui
débarquèrent dans leur campus à la fin des
années soixante."
(271) Il ne semble pas que les étudiants qui se
trouvent dans la résidence universitaire de Peter soient
très motivés par leurs études, qui ne leur
paraissent servir à rien si ce n'est à obtenir les
notes qui permettront de garder leur bourse universitaire. Ils ne
s'intéressent alors au Vietnam que lorsqu'ils songent au
sursis qui leur permet de l'éviter. La vie consiste à
s'évader dans des parties de cartes interminables, les sorties
et les filles, seules occupations qui présentent quelque
intérêt.
La plupart des étudiants ne se
mêlent pas aux débats pour ou contre la guerre, et
presque tous ignorent, comme Peter, que dans le passé
"le Viêt-nam avait
autrefois été aux mains des
Français", et,
à plus forte raison, ce qui était arrivé aux
"malchanceux monsieurs qui
s'étaient retrouvés dans le camp retranché de
Diên Biên Phu en 1954". Ils ne savent pas davantage que l'état
américain veut en ce moment se débarrasser du pouvoir
civil au Vietnam, et a décidé qu'il était temps
"pour le président
Diêm d'être évacué vers les vastes
rizières célestes afin que Nguyên Cao Ky et ses
généraux puissent prendre le pouvoir" (327) Ils pensent
qu'ils n'ont rien à reprocher aux Vietnamiens personnellement,
et que les Martiens pourraient débarquer plus facilement
qu'eux aux États-Unis...
Mais, en cette rentrée 1966,
les événements se précipitent : "À Greenwich Village, une marche pour la
paix fut dispersée fort peu pacifiquement par la police. Les
manifestants n'avaient pas d'autorisation, déclara-t-elle.
À San Francisco, d'autres manifestants, portant des
crânes en plastique au bout de bâtons et des masques
blancs de mimes, furent dispersés, eux, à coups de gaz
lacrymogène. À Denver, la police arracha des milliers
d'affiches annonçant un rassemblement pour la paix au
Viêt-nam au Chautauqua Park, à Boulder. (...)
Dans notre petit coin, un
sit-in fut organisé à l'Annexe Est, le bâtiment
où la société de produits chimiques Coleman
conduisait ses entretiens d'embauche. Coleman, comme Dow, fabriquait
du napalm. Coleman fabriquait également l'Agent Orange, des
composés botuliques et des germes d'anthrax, ce que l'on ne
découvrit cependant qu'en 1980, lorsque l'entreprise fit
faillite." (317)
À ce moment, les mouvements contre la guerre au Vietnam
étaient une nouveauté dont on n'avait pas encore
mesuré le pouvoir de nuisance contre les autorités en
place, et les forces chargées du maintien de l'ordre se
montraient encore pacifiques. Le bruit causé dans les
médias fait cependant que, peu à peu,au cours de ce
trimestre, les étudiants prennent conscience :
"De plus en plus, nous nous
retrouvions en train de discuter, pendant que l'on battait les cartes
et qu'on les distribuait, non pas de cinéma, de filles ou de
cours, mais du Viêt-nam. Peu importait que les nouvelles soient
excellentes et que le nombre des victimes, parmi le
Viêt-công, soit faramineux, il y avait toujours une photo
montrant des soldats américains morts de trouille après
une embuscade ou des petits Vietnamiens en larmes, regardant leur
village partir en fumée. Toujours quelque détail
dérangeant au bas de ce que Skip appelait la «colonne
quotidienne des tués», comme par exemple l'histoire des
enfants qui se trouvaient à bord des bateaux coulés par
nos canonnières, dans le delta du
Mékong." (327) Deux
éléments paraissent toucher King : la peur
qu'éprouvent les soldats au combat, les comportements
anti-humanitaires de l'armée à l'égard de la
population.
La découverte du signe de la paix se fait par étapes.
Un premier étudiant arbore le signe de la paix sur son
blouson, qu'un autre, aux compétences éclatantes,
explique : "«Une
combinaison de deux signes de sémaphore de la marine
britannique. Regardez.»
Nate se leva et se mit au garde-à-vous; puis il leva le bras
gauche verticalement, laissant tomber le droit vers le plancher, pour
former une ligne droite. «Ça, c'est le N» Ensuite,
il écarta les bras à quarante-cinq degrés par
rapport à son corps. Je compris alors comment les deux
attitudes, une fois superposées, formaient le signe que Stoke
avait tracé à l'encre sur son vieux duffle-coat.
«Et ça, c'est le D.
- N-D, dit Skip. Et alors?
- Ce sont les deux premières lettres de Nuclear Disarmament.
C'est Bertrand Russell qui a inventé le symbole, dans les
années cinquante. (...) C'est le
signe de la paix.»"
(337)
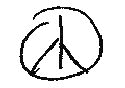
Peter, l'étudiant narrateur,
le dessine à son tour sur son blouson : "Le dessin une fois terminé, je tins le
blouson à bout de bras pour l'examiner. Dans la lumière
blanche et faible de l'unique néon allumé, il avait un
côté dur et ostentatoire tout en présentant
quelque chose d'enfantin. Mais il me plaisait. J'aimais bien cette
connerie. Je n'étais pas trop sûr de ce que je pensais
de la guerre, même alors, mais l'empreinte de moineau me
plaisait beaucoup."
(377) On retiendra le caractère puéril de cette
remarque, manquant totalement de maturité. Peter, alias King,
semble choisir un symbole comme on choisit n'importe quel objet de
plaisir, selon des caractéristiques esthétiques.
D'autres font une analyse plus
profonde et prennent conscience. Certains posent des affiches, et
représentent la relation entre la guerre et les milieux
d'affaires : "Un jour ou deux
plus tard, mon ami Skip, arrivé en fac avec le niveau de
conscience politique d'un mollusque, afficha un poster dans son coin
de la chambre (...).
Dessus, on voyait un homme
d'affaires en costume trois pièces. Il tendait cordialement la
main droite. Il tenait la gauche dans son dos, mais du sang
dégoulinait de ce qu'elle agrippait. LA GUERRE EST BONNE POUR LES AFFAIRES, lisait-on en dessous. INVESTISSEZ VOTRE FILS.
Dearie fut horrifié.
«Tu es contre la guerre du Viêt-nam, à
présent?» demanda-t-il à Skip lorsqu'il la
vit.
«Hé, répondit-il, tout ce que ce poster veut dire,
c'est qu'il y a des tas de gens qui profitent de ce sanglant massacre
pour s'en mettre plein les poches. McDonnell-Douglas, Bocing, General
Electric, Dow Chemicals et Coleman Chemicals, Pepsi bon Dieu de Cola.
Et des tas d'autres.»"
(351)
D'autres réagissent, se mettent à lutter ouvertement,
créent des comités pour des raisons idéologiques
: "«Ce que je pense,
c'est que Johnson envoie de jeunes Américains se faire tuer
là-bas pour rien. Ce n'est pas une histoire
d'impérialisme ou de colonialisme. (...)
Je devrais essayer de
l'arrêter. C'est ce qu'on m'a appris au catéchisme,
à l'école et même dans ce fichu bouquin, Boy
Scouts of America. On est supposé résister. Quand on
voit se produire quelque chose qui est mal, on attend de toi que tu
t'y opposes, que tu essaies au moins de l'empêcher, comme quand
on voit un gros costaud qui bat un petit." (336)
Le groupe d'étudiants en est
arrivé à avoir suffisamment de sentiment de
solidarité envers la cause pour soutenir l'un des leurs, qui
est l'objet d'une enquête du doyen pour avoir tagué un
édifice avec la «patte de poulet». Et le plupart se
mettent à porter aussi le signe de la paix, par esprit de
corps sans doute plus que par conviction.
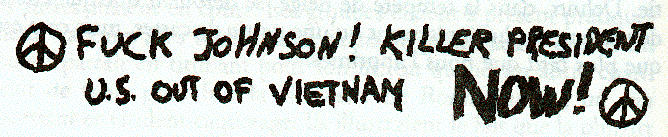
Les profs changent aussi d'attitude,
se montrent moins sévères, prennent conscience des
conséquences de leur choix : "Dans l'ensemble, les professeurs se montrèrent
beaucoup plus ouverts que nous ne nous y attendions; la plupart se
débrouillèrent non seulement pour nous faire passer,
mais pour nous faire passer avec des notes suffisamment correctes
pour que nous ne perdions pas nos bourses. (...) Des
années plus tard, j'ai compris que, pour la plupart de nos
enseignants, il s'était davantage agi d'une question morale
que de réussite scolaire : ils ne tenaient pas à
découvrir le nom de l'un de leurs ex-étudiants dans la
liste des morts pour la patrie; ils ne tenaient pas à se
demander s'ils n'en étaient pas partiellement responsables;
à se demander encore si la différence entre un C et un
D ne s'était pas traduite par la différence entre un
gosse qui pouvait voir et entendre et un autre qui s'étiolait,
aveugle ou sourd, ou les deux, dans un hôpital pour
vétérans, quelque part dans le pays." (425/6)
Des allusions sont faites à d'autres événements
qui ne se produiront que plus tard. L'une concerne l'évolution
des circonstances. Un an et demi plus tard, Peter était en
prison à Chicago : "J'ignore combien d'entre nous les flics avaient
arrêtés ce soir-là, devant l'immeuble où
se tenait la convention démocrate qui vit la nomination de
Hubert Humphrey à la candidature présidentielle, mais
nous étions très nombreux, et il y avait beaucoup de
blessés; une commission d'enquête, une année plus
tard, allait parler d'une «véritable émeute
policière» dans son rapport.
Je me retrouvai dans une cellule conçue pour quinze personnes,
vingt tout au plus, en compagnie d'une soixantaine de hippies
gaz-lacrymogénés, matraqués, bourrés de
drogue, sonnés, battus, crevés, ensanglantés,
dont certains avaient encore la force de tirer sur un joint tandis
que d'autres pleuraient, que quelques-uns dégobillaient, ou
encore entonnaient des chants de protestation." (431)
L'autre, moins banale, évoque
les répercussions des événements sur la
conscience artistique de certains créateurs : "En 1969, il avait déjà une
idée plus juste de ce qu'il était; c'est l'année
où il fabriqua ce tableau d'une famille vietnamienne en
carton-pâte auquel on mit le feu; cela se passait à la
fin d'un rassemblement pour la paix qui s'était tenu devant la
bibliothèque Fogler, pendant que les Younghloods jouaient Get
Together grâce à des amplis d'emprunt, et que des
hippies à temps partiel marquaient la cadence comme des
guerriers du néolithique après une chasse. Vous voyez
à quel point tout cela se mélange dans ma tête?
Mais c'était l'Atlantide, voilà qui est indiscutable,
l'Atlantide tout au fond de l'océan. La famille en carton
brûla, les manifestants hippies entonnèrent
«Napalm! Napalm! Célestes excréments!» tout
en dansant, et au bout d'un moment, les va-t-en guerre et les types
des associations se mirent à leur lancer des choses. Des
oeufs, pour commencer. Puis des pierres." (305/6)
Plus tard, des critiques
s'interrogent sur la rage qu'exprime l'oeuvre de cet étudiant
devenu artiste, "rage que j'ai
vu se manifester clairement pour la première fois dans le
tableau d'une famille vietnamienne en carton à laquelle il
avait mis le feu devant la bibliothèque, en 1969, avec le
martèlement des Younghloods en fond sonore. (...)
C'est de la colère
qu'expriment la plupart de ses sculptures; ses personnages aux
épaules raides en papier, plâtre et argile, semblent
murmurer, Oh, enflammez-moi enflammez-moi et écoutez-moi
hurler, on est encore en 1969 en réalité, c'est encore
le Mékong et ça le sera toujours. «C'est la
colère de Stanley Kirk qui donne sa force à son
oeuvre», a écrit l'un de ces critiques, lors de son
exposition à Boston, et je suppose que c'est cette même
colère qui a présidé à sa crise
cardiaque, il y a deux mois."
(433)
Le lecteur qui connaît les événements est
cependant déçu par les limites de cette prise de
conscience. On ne subit une telle évolution, peut-on croire,
que par une prise de conscience politique des problèmes d'une
société en crise, une analyse, serait-elle sommaire,
des dysfonctionnements d'une collectivité mal dirigée
et mal régulée. La suite logique de l'intransigeance de
Rage. On pouvait admettre que, plus tard, l'étudiant
King, déçu par les faiblesses d'une position politique
morale, mais idéaliste, prenne à la sortie de la fac
ses distances avec tout mouvement révolutionnaire, ou
simplement contestataire. Mais quand il se décide, plus de
trente ans plus tard, à évoquer ces années,
c'est pour ramener des événements historiques à
des situations individuelles d'enfance, de révolte ou de
repentance... Carol, une fillette qui a joué un grand
rôle dans le premier récit, qu'on retrouve ici
étudiante, participe à des manifestations politiques
contre le Vietnam. Pas de véritable justification politique :
elle répond à une impulsion qui vient de son enfance,
quand, agressée et blessée par trois loubards, elle a
été secourue par un camarade, Bobby : "C'est alors que Bobby est arrivé. Il
m'a raccompagnée hors du parc et m'a portée jusque chez
lui. Il a remonté tout Broad Street Hill alors qu'il faisait
une chaleur écrasante. Il m'a portée dans ses bras."
(345) Il a ensuite, bien que plus faible, donné une
solide raclée à l'agresseur Harry : "La seule chose qui mérite que je m'en
souvienne, c'est que Bobby Garfield a pris fait et cause pour
moi. (...)
J'ai toujours voulu lui dire
combien je l'aimais pour ça, et combien je l'aimais pour avoir
montré à Harry Doolin qu'on ne s'en tirait pas comme
ça quand on s'en prenait aux gens, en particulier à
ceux qui sont plus petits que vous et qui ne vous veulent pas de
mal." (346) Il est
décevant de voir quelles leçons politiques King tire de
cet incident ordinaire dans la vie des enfants : l'agressée,
devenue étudiante à l'université, participe
à des manifestations contre la guerre du Vietnam pour
remercier rétrospectivement celui qui lui a porté
secours. Pour qui a vécu l'effervescence bouillonnante des
idées à cette époque, la comparaison et la mise
en critique des systèmes politiques et sociaux existants, le
radicalisme dans la remise en cause des institutions, il paraît
bien mince de voir ramener des prises de position fondamentales
à un geste d'altruisme consécutif à un
traumatisme vécu dans l'enfance. Pas meilleure se
révèle la prise de position collective du groupe
d'étudiants en faveur d'un handicapé qui risque
l'exclusion pour avoir tagué un mur d'une inscription contre
la guerre : leur soutien ne vient-il pas du fait qu'ils se sont
d'abord abondamment moqués de cet handicapé qui avait
fait une chute? Et leur approbation du signe de la paix de Russell
(la patte de poulet américain!) tient de l'imitation et du
remords, et non d'une conviction profonde. La prise de conscience
politique est dérisoire. De la psychologie - et d'envergure
limitée - utilisée pour expliquer l'histoire...
On ne saurait mieux dire les limites
des prises de conscience chez King des insuffisances ou des tares de
notre société. Le refus partiel de ce monde se traduit
chez lui par une tendance à se tenir en marge d'une
société sur laquelle il porte un regard
acéré et critique, mais que, finalement, il est
incapable de vraiment dominer. King est remarquablement doué
pour saisir des situations individuelles, et tout se ramène,
dans son oeuvre, aux comportements d'individualités. Qu'il ait
personnellement vécu ainsi ces événements n'est
pas singulier. La plupart les ont traversés aussi sans rien
voir, ou n'y ont vu que des opportunités comme celle de
«se lever» une fille en participant à un mouvement.
Mais on pouvait attendre davantage : quelle force cette
période aurait-t-elle pu prendre dans cette novella si elle
avait été vécue par un Charlie comme dans
Rage, le King lycéen contestataire et sans
concession de dix-sept ans? Si elle avait été
décrite dans la foulée de Rage, ou de Marche ou Crève, au moment même des événements? On
retrouvera une situation identique dans la nouvelle suivante.
 éd. UK
Une curieuse
pénitence en 1983.
(Willie
l'aveugle)
éd. UK
Une curieuse
pénitence en 1983.
(Willie
l'aveugle)
La novella Chasse-coeurs a permis de préparer le terrain pour les deux
autres récits qui se déroulent en 1983 et à
notre époque. Le tourbillon de ce dernier trimestre 1966 a
disparu, remplacé par un mal-être, un manque, une sorte
de grand vide que les personnages, amers, aigris, voire
déboussolés ou torturés ne savent comment
combler. Dans les deux nouvelles suivantes, ils sont hantés
par les souvenirs de leur passé. L'un paie curieusement en
mendiant, l'autre en étant sans cesse hanté par un
fantôme.
Willie n'aime plus les gens, et les
évite. Le train qu'il prend chaque jour lui est pénible
: "La crasse du vitrage
la fait rassembler
[la ville] à quelque ruine titanesque couverte
d'ordures - l'Atlantide, défunte, par exemple, remontée
à la surface pour jeter un regard mauvais sur le ciel gris.
(441) Un de ses voisins de bureau lui paraît avoir
"la tête de la Mort vue
par un dessinateur humoristique, des yeux énormes, des dents
énormes, la peau brillante et tendue. Ce sourire lui fait
penser à Tam Boi, dans la vallée d'A Shau. Ces types du
2e bataillon arrivés là comme s'ils étaient les
rois du monde, pour en ressortir en ayant l'air de rescapés du
dernier cercle de l'enfer rôtis au troisième
degré. Ils avaient ces mêmes yeux énormes, ces
mêmes dents énormes. Ils avaient encore cette tête
à Dong Ha, où ils s'étaient retrouvés
plus ou moins mélangés, quelques jours plus
tard." (444)
Willie a un bureau d'affaires
immobilières où ne se trouve aucun employé,
puisqu'il ne s'y passe rien : il sert seulement, grâce à
un singulier arrangement architectural, à permettre à
Willie de troquer sa tenue d'homme d'affaires chic contre celle d'un
mendiant affroqué d'un uniforme de soldat du Vietnam. Willie
est l'un de ceux qui a agressé Carol. Esprit religieux,
marqué par l'enseignement qu'il a reçu, il en
éprouve un irrépressible remords. Du Vietnam, il a
réussi à se sortir sans trop de casse :
"Sur l'un des murs, est
accrochée la reproduction d'un Norman Rockwell
représentant une famille au moment de la prière de
Thanksgiving. Derrière le bureau, on voit une photo de studio
encadrée : c'est Willie en uniforme de lieutenant (photo prise
à Saigon peu avant qu'il reçoive sa première
décoration, une Silver Star, pour son comportement sur le lieu
du crash d'un hélicoptère, non loin de Dong Ha) et,
à côté, un agrandissement de son certificat de
démobilisation, également encadré. On y lit son
nom, William Shearman, et ses décorations sont dûment
mentionnées. Il a sauvé la vie de Sullivan sur la
piste, dans les environs du patelin. C'est ce que proclame la
citation accompagnant la Silver Star, c'est ce qu'ont
déclaré les hommes ayant survécu à Dong
Ha, et bien plus important encore, c'est ce qu'a affirmé
Sullivan lui-même. C'est même la première chose
qu'il a dite lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux dans
le même hôpital, à San Francisco, celui qu'on
avait surnommé le Pussy Palace 30. (...) C'était le jour où le photographe d'AP les
avait pris en photo; et la photo avait paru dans tous les journaux du
pays. (...)
Au-dessus du portrait de
studio et du certificat de démobilisation, est punaisé
un poster des années soixante. Il n'est pas encadré et
commence à jaunir sur les bords, et il représente le
symbole de la paix. En dessous, en bleu, blanc et rouge, figure ce
commentaire :
EMPREINTE DU GRAND POULET
AMÉRICAIN."
(448)
Willie pour mendier porte des lunettes noires, puiqu'il veut passer
pour un aveugle de guerre. Mais Willie souffre d'hystérie et
sa cécité passagère n'est pas feinte : elle
durera le temps qu'il quêtera. L'hystérique exprime en
effet sur le mode corporel un conflit d'ordre émotionnel, qui
exprime tel comportement du corps en fonction de sa signification
symbolique. Le symptome traduit en même temps la
barrière inconsciente qui s'est dressée dans l'esprit
du patient, dans certains cas, comme ici, pour permettre une
compensation symbolique d'une faute commise. Ce symptome est un
compromis qui essaie de déplacer l'angoisse sur un
comportement substitutif, la mendicité devenant ici l'acte de
rachat de la faute commise, et pour laquelle, jadis, un prêtre
auquel il s'était confessé lui a demandé de
faire pénitence. S'il porte des lunettes noires, ce n'est pas
afin de se dissimuler : "Dès quatorze heures, il sera réellement
aveugle, exactement comme il ne cessait de le hurler lorsque lui,
John Sullivan et Dieu seul sait combien d'autres s'étaient
retrouvés évacués d'urgence dans la province de
Dong Ha, dans les années soixante-dix. Je suis aveugle!
criait-il déjà tandis qu'il entraînait Sullivan
hors du sentier, mais il n'avait pas été aveugle, pas
vraiment 31; dans la blancheur éclatante
zébrée de pulsations, après l'éclair de
lumière, il avait vu Sullivan rouler par terre en essayant
d'empêcher ses tripes de se répandre. Il l'avait
ramassé et avait couru, après l'avoir maladroitement
jeté sur une épaule. Sullivan était plus grand
que Willie, beaucoup plus grand et plus lourd, et Willie se demandait
encore comment il avait pu porter un tel poids, et cependant il
l'avait fait, il avait parcouru tout le chemin jusqu'aux
hélicos dans la clairière (...) tandis que
les balles sifflaient autour d'eux et que des morceaux de corps
humains fabriqués en Amérique gisaient sur la piste,
à l'endroit où la mine, ou la bombe
piégée, ou la foutue saloperie avait explosé."
(457)32 Un passage est consacré à cette
conversion symbolique vestimentaire de Bill en Willie, qui change
alors de personnage pour devenir son double compensateur.
(456)
Willie a gardé tout un dossier
sur Carol et sa mort supposée. Devenue activiste, elle a, avec
son groupe, fait sauter un immeuble en 1970, attentat qui a
occasionné des morts et des blessés. Poursuivie par la
police, elle aurait brûlé vive dans l'incendie de la
maison où elle s'était réfugiée. Certains
croient qu'elle a réussi à s'enfuir à temps.
Willie continue à s'interroger sur son sort. Moins cynique que
les autres adolescents brutaux, plus scrupuleux aussi, il a
gardé de son erreur de jeunesse le désir de se
repentir, et passe son temps à recopier interminablement sur
des cahiers : je suis désolé.
Willie est aussi bien marqué
par sa guerre du Vietnam que par l'épisode pendant lequel
Carol a été battue. Il s'est inventé une vie
compliquée et peu compréhensible, pour concilier les
apparences d'un homme d'affaires vivant dans l'aisance et la pratique
de la mendicité, sa seule source de revenu (il vaut mieux
passer sur l'épisode tortueux du passage d'un bureau à
un autre par une trappe qu'il a spécialement
aménagée). Sur son trottoir, il se présente
comme un ancien du Vietam, médaillé, mais
oublié, et, dans ses vêtements militaires, parle
occasionnellement de ce qu'il a vu là-bas. Signe concret de
son remords, il collecte l'argent des donateurs dans le gant de
base-ball abandonné par Bobby lors du sauvetage de Carol. Sa
longue pénitence tient lieu de confession, mais il s'arrange -
autre contradiction singulière - pour garder les billets des
donateurs pour lui sans remords, en n'offrant que les pièces
aux églises, mêlant ainsi Dieu à ses curieuses
manigances. Par ailleurs, contradictoirement avec ses idées de
repentance, il pense faire disparaître un policier
véreux qui le rançonne. On ne peut pas dire que la
nouvelle, avec ses curiosités, suscite particulièrement
l'enthousiasme.
 Le
fantôme du Vietnam vit encore en 1999.
(Pourquoi nous
étions au Vietnam).
Le
fantôme du Vietnam vit encore en 1999.
(Pourquoi nous
étions au Vietnam).
Le quatrième texte du recueil
met en scène, à la même date, le petit ami de
Carol, Sully-John, lui aussi marqué par le le souvenir de
Carol la Rouge. Jadis sauvé par Willie au VietNam, il est
hanté par le souvenir d'une vieille femme indochinoise que
Malenfant, le passionné de cartes de l'université
retrouvé là-bas, a tué à coups de
baïonnette lors d'une opération, un meurtre :
"Je n'arrivais pas à
croire à ce qui arrivait. Je crois que Malenfant
lui-même n'y croyait pas, au début. Il a commencé
par deux petits coups de baïonnette, c'est à peine s'il
la piquait de la pointe, comme si toute cette affaire n'était
qu'une blague... puis il l'a fait, il lui a enfoncé la
baïonnette dans le corps. Ah, le con, Sully, vraiment, le con!
Elle s'est mise à hurler et à tressauter en tout sens,
et lui, tu te rappelles, il se tenait les pieds écartés
au-dessus d'elle.
(...) J'avais la
trouille, Sully, j'avais une putain de trouille à en crever.
Je savais que mon rôle était de mettre un terme à
ça, mais j'avais peur qu'ils me flinguent si
j'essayais. (...)
Tu te rappelles comment elle a
hurlé, cette vieille femme, quand il l'a embrochée?
Comment il la dominait de toute sa taille, n'arrêtant pas
d'éructer, la traitant de conne, de niakouée, de
chinetoque et de tout ce que tu voudras... Heureusement, il y a eu
Slocum. Il m'a regardé, et ça m'a obligé
à faire quelque chose... à ceci près que je lui
ai seulement dit de tirer.»" (525) En fait, il n'a rien dit et Slocum a
tiré de lui-même. Il est donc partiellement coupable. Ce
Slocum plus tard se serait suicidé en se jetant à 120
à l'heure sur une pile de pont.
Depuis, il voit le fantôme
partout : "La vieille mama-san
était restée. La vieille muma-san avait tenu bon.
Durant les sept mois passés par Sully à l'hôpital
des anciens combattants de San Francisco, elle était venue
tous les matins et tous les soirs, sa visiteuse la plus ponctuelle au
cours de ce temps qui n'en finissait pas, où le monde entier
paraissait sentir la pisse et où son coeur lui faisait mal
comme une migraine. Parfois, elle arrivait vêtue d'un muumun
33, comme les hôtesses d'un luau pour
cinglés, (...)
la plupart du temps, elle
portait la même chose que le jour où Malenfant l'avait
tuée : le pantalon vert, la tunique orange et les chaussures
rouges couvertes de symboles chinois." (491)
Sully-John vend des voitures. Il lui
est arrivé de voir le fantôme dans un véhicule,
"la vieille mamasan assise,
côté passager, dans une Ford LTD de 1968 avec
AFFAIRE DU JOUR! écrit au blanc d'Espagne sur le
pare-brise". Sully-John s'est
fait soigner par un psychothérapeuthe et, avec le temps, la
voit moins : "Vous finirez par
comprendre le sens de sa présence avec le temps, lui avait
déclaré le psy de San Francisco, refusant de donner
plus de précisions, en dépit des demandes pressantes de
Sully. Le psy voulait qu'il lui parle des hélicoptères
qui s'étaient heurtés en vol; le psy voulait savoir
pourquoi Sully parlait si souvent de Malenfant comme de «ce
salopard de joueur de cartes» (Sully refusait); le psy voulait
savoir si Sully avait des fantasmes sexuels, et si oui, s'ils
étaient devenus violents." (492) Le Dr Conroy lui a affirmé qu'il
finirait par comprendre le sens de la présence de la mama-san.
La chose la plus importante était de prendre conscience
"à un niveau
viscéral" que le
fantôme n'était pas là. Il a emprunté au
Dr Conroy certains de ses bouquins et il en a trouvé deux ou
trois autres à la bibliothèque de l'hôpital,
grâce à un prêt interbibliothèques.
D'après les ouvrages en question, "la vieille mama-san en pantalon vert et tunique orange
était un «fantasme extériorisé» qui
servait de «mécanisme de transfert» pour l'aider
à tenir le coup face à sa «culpabilité de
survivant» et au «syndrome de stress post-traumatique»
dont il souffrait. En d'autres termes, elle n'était qu'une
sorte de rêve éveillé.
Toujours est-il que son attitude vis-à-vis d'elle changea au
fur et à mesure que ses apparitions devinrent moins
fréquentes. Au lieu d'éprouver de la répulsion
ou une sorte de crainte superstitieuse, il commença à
se sentir presque heureux de la voir. Un peu comme lorsqu'on revoit
un ancien ami ayant quitté la ville, mais qui y revient pour
une petite visite, de temps en temps." (493)
Si Sully-John se débrouille
pour vivre avec son fantôme, il lui arrive de se souvenir de
scènes atroces du Vietnam, et il y en a plusieurs de bonne
longueur de ce genre danns cette nouvelle : "Dans les hélicos descendus des hommes hurlaient
aussi, alors ils les en avaient extraits, balancé la mousse
carbonique sur l'incendie et ils les en avaient sortis, sanf que
c'était plus des hommes, pas ce qu'on aurait pu appeler des
hommes, c'était rien que des plateaux-repas hurlant, pour la
plupart, des plateaux repas avec des yeux et des boucles de ceinture,
et ces doigts cliquetant tendus vers vous, de la fumée montant
des ongles fondus, ouais, comme ça, pas le genre de truc qu'on
pouvait raconter à des types comme le Dr Conroy. Comment
raconter que quand on essayait de les tirer de là, des
morceaux d'eux se détachaient, glissaient, si l'on veut, comme
un morceau de dinde bien cuite glisse sur la graisse bouillante
liquéfiée en dessous, ouais, comme ça, et
pendant tout ce temps l'air était imprégné de
l'odeur du kérosène et de la jungle. Ça arrivait
vraiment, c'était vraiment vraiment le grand show, comme Ed
Sullivan aimait à le dire, planqué derrière son
petit écran, oui, tout ça se passait sur notre
scène et tout ce qu'on pouvait faire c'était suivre le
mouvement et essayer de s'en sortir." (499)
Pris dans un bouchon sur l'autoroute
où il mourra d'un arrêt cardiaque, Sully-John vit ses
derniers moments avec son fantôme : "Elle ne répondit pas, mais l'avait-elle jamais
fait? Elle restait tranquillement assise, mains croisées, le
regardant de ses yeux noirs, une vision de Halloween en vert, orange
et rouge. La vieille mama-san n'avait rien à voir avec les
fantômes d'un film hollywoodien, cependant; on ne voyait pas
à travers elle, elle ne changeait jamais de forme, elle ne
s'évanouissait pas progressivement en fumée. Elle
portait à son poignet jaune décharné une sorte
de cordon comme ceux que se mettent les adolescents en signe
d'amitié. Et bien que l'on ait pu voir chaque tortillon de ce
cordon et chaque ride de ce visage si vieux, on ne pouvait sentir son
odeur; et la seule fois où Sully avait essayé de la
toucher, elle avait aussitôt disparu. Elle était un
fantôme qui habitait sa tête. À ceci près
que, de temps en temps (en général sans douleur et
toujours sans avertissement), la tête de Sully la vomissait en
un endroit où il était obligé de la
regarder." (503)
Il pense qu'on voit ses lèvres bouger, et qu'on doit le
prendre pour un radoteur : "Si
jamais quelqu'un le voyait, depuis une autre voiture (la Caprice
était cernée de tous les côtés, à
présent, complètement enclavée), il supposerait
qu'il chantait avec la musique, c'est tout. Et puis même s'il
pensait autre chose, qu'est-ce qu'il en avait à foutre ?
Qu'est-ce qu'il en avait à foutre de ce qu'ils pensaient tous
? Il avait vu des choses, des choses terribles, dont l'une des pires
avait été une longueur de ses propres intestins
reposant sur le matelas ensanglanté de ses poils pubiens; et
si de temps en temps il voyait ce vieux fantôme et même
lui parlait, qu'est-ce que ça pouvait foutre? C'était
son affaire, non?"
(503) Comme on le voit, s'il a réussi à vivre
avec son fantôme, Sully-John est un homme fini, qui survit par
habitude. Le destin des anciens combattants n'est pas
meilleur.
 Les
séquelles du Vietnam selon King.
Les
séquelles du Vietnam selon King.
À l'enterrement d'un ancien du
Vietnam, il évoque avec son ancien lieutenant la situation de
ceux qui sont revenus de là -bas, la plupart malades :
"Pags était mort d'un
cancer. À chaque fois que mourait l'un des anciens copains de
Sully au Viêt-nam.
(...), on aurait dit
que c'était soit du cancer soit à cause des drogues,
soit un suicide. En général, le cancer
commençait par le cerveau ou les poumons et se mettait en
suite à cavaler partout, à croire que ces hommes
avaient laissé leur systéme immunitaire dans la jungle.
Dick Pagano, lui, avait eu droit a un cancer du
pancréas."
(495) Ces maladies sont attribués à divers
«agents» toxiques employés pendant la guerre,
notamment l'Agent Orange : "Personne ne peut le prouver mais nous, nous le savons.
L'Agent Orange
34, le cadeau
concédé à
perpétuité.»"
Les statistiques ont exposé
les divers maux dont souffrent les vétérans plus que
les autres, et ils sont énoncés longuement dans la
nouvelle : dépression, alcoolisme, drogue, menaces de suicide
ou suicides. Ces hommes souffrent d'une mauvaise dentition, d'un
excès de poids (le gros estomac, "la cambuse à Bud", marque de bière), se plaisent aux beuveries.
Leur taux de divorce est très important : "Les anciens combattants étaient dans
l'ensemble des emprunteurs à risque comme vous l'aurait dit
n'importe quel directeur d'agence bancaire. (...) Les
anciens combattants abusaient de leurs cartes de crédit, se
faisaient mettre à la porte des casinos, (...)
sortaient le couteau à
la moindre dispute au cours d'une partie de dés dans les bars,
achetaient à crédit des voitures gonflées qu'ils
transformaient rapidement en épaves, battaient leur femme,
battaient leurs mômes, battaient jusqu'à leurs cons de
chiens et se coupaient probablement plus souvent, en se rasant, que
les gens qui n'avaient jamais vu de près ou de loin la
verdure, la brousse, la cambrousse - sinon dans des films comme
Apocalyse Now ou cette connerie intitulée Voyage au bout de
l'enfer." (507/8)
King effectue ensuite une confusion certaine entre la
génération des sixties en général, et les
vétérans du Vietnam. Ce qu'il reproche aux sixties
s'adresse à tous, et quand Sully-John évoque longuement
et avec amertume la situation de désespérance des
survivants des années soixante, c'est à la suite d'une
analyse primaire de la situation, qui ne tient que de
l'idéologie, et aucunement des évolutions
matérielles et économiques qui touchent tous les pays
développés : "Notre conception d'un grand changement dans la vie se
résume à l'achat d'un clébard. Les filles qui
ont brûlé leur soutien-gorge autrefois achètent
maintenant de la lingerie en soie et les types qui baisaient
témérairement pour la paix sont maintenant des
obèses qui restent tard le soir devant l'écran de leur
ordinateur, et se tirent la tige en regardant des photos de gamines
de dix-huit ans sur Internet. C'est nous, tout ça, frangin, on
aime bien mater. (...)
Mais il y a eu une
époque... ne rigole pas, vieux, il y a eu une époque
où nous avions tout entre les mains. Vraiment. Tu ne savais
pas?" (528) Que font-ils
maintenant, si ce n'est remplir leurs "portefeuilles en jouant à la Bourse"? "Nous
sommes allés de salles de gym en séances de
thérapie pour ne pas perdre le contact avec
nous-mêmes.
(...) Nous avons tout
de même fini par surmonter cette haine de soi, nous avons tout
de même fini par être contents de nous, alors tout va
bien.»" (529)
Le résultat, c'est que tous semblent déplorer la
civilisation de consommation tout en en vivant bien :
"«Je n'ai que
mépris et dégoût pour cette
génération elle-même, Sully. L'occasion nous a
été offerte de tout changer. Elle nous a
été vraiment offerte. Au lieu de quoi, nous avons
préféré les jeans haute couture, des billets
pour aller écouter Mariah Carey, les points de
réduction passager régulier pour prendre l'avion, le
Titanic de James Cameron, et les comptes épargne-retraite. La
seule génération qui se rapproche de la nôtre,
pour ce qui est de ne rien se refuser, en termes
d'égoïsme pur, est celle qu'on a appelée la
génération perdue, la génération des
années vingt; mais au moins, eux avaient la décence de
ne jamais dessoûler. Nous n'avons même pas
été capables de faire cela. On est vraiment nuls, mon
vieux.»" (529)
Passons sur les illusions que contient cette affirmation. Il y avait
beaucoup d'égoïsme frustré et de recherche de
satisfactions immédiates dans le comportement des jeunes de la
fin des années soixante, à côté d'une
véritable générosité et surtout, une
croyance quasi absolue dans le pouvoir de l'imagination. Rien n'est
plus labile et vague que les suggestions de l'imaginaire, où
le réel est complètement mis de côté. King
croit-il lui-même qu'à cette période, tout
était possible? Il n'a pas dû le croire longtemps, et,
dans son attitude, il y a beaucoup de romantisme littéraire,
piquant chez un auteur qui gagne des milliards. Lui-même
déclarait, à sa sortie de l'université, dans la
dernière de ses chroniques du Maine Campus (21 mai 1970) qu'il
est bien revenu de ses espérances : "Si quelqu'un, alors qu'il prenait conscience des
réalités, a pu dire qu'il allait «changer le monde
avec la vigueur et l'oeil brillant de la jeunesse», maintenant
ce jeune homme est prêt à tout envoyer promener et
à prendre la fuite, comme un homme qui ne se sent plus
tellement l'oeil brillant; en fait, il se sent vieux de deux cents
ans." 35 La désillusion des jeunes des
années soixante n'est donc pas récente, et elle a suivi
de près les événements. Ce qui se passe avec sa
génération ne devrait donc pas l'étonner... Il
est facile de se moquer des «vieux» soixante-huitards se
masturbant devant leur télé... Ils sont loin
d'être les seuls. Oserai-je utiliser le terme d'exemple
«simpliste»?
Le seul qui semble avoir
échappé à ces états d'âme est
Malenfant, le grossier joueur acharné de cartes de
Chasse-coeurs, le
joyeux luron, l'assassin de la vieille indochinoise dont le
fantôme a suivi si longtemps Sully. Alors que Marinville
l'écrivain, l'ancien du Vietnam, se rachetait d'une vie mal
vécue alors qu'il n'avait commis aucun assassinat, pour
Malenfant le tueur, tout est "tout est cinq sur cinq". Malenfant a trouvé une puissance
"qu'il a choisi d'appeler
Dieu". Avec lui,
"il a vécu une seconde
naissance, (...)
il vit la vie comme elle doit être vécue, il laisse
faire les choses, il laisse faire Dieu - bref, tout le baratin que
ces mecs-là se racontent. (...) Sainte
merde, dit Sully, surpris de l'ampleur de sa colère. La
vieille muma-san serait certainement contente de savoir que Ronnie a
surmonté ça. Je le lui dirai, la prochaine fois que je
la verrai." (527)
À noter que son cas ressemble singulièrement à
celui du Lt Beevers, dans Koko de Straub,
qui a tué 30 enfants dans une grotte au Vietnam, mais qui est
le seul de sa section à ne pas vouloir se sentir coupable,
refoulant sans cesse les éléments qui lui prouvent sa
médiocrité et ses insuffisances, qu'il lie à son
enfance et aux circonstances.
BILAN.
Le contexte historique de la guerre
froide et de l'affirmation de la jeunesse comme force autonome
paraîtra sommaire à celui qui a connu cette
époque, mais suffira peut-être aux autres. La sinistrose
de ces années de fac privées de sens pour beaucoup
d'étudiants, la confusion de leurs sentiments, la peur des
parents qui continuent à jouer un rôle important,
l'absence de perspective des sentiments amoureux donnent à
l'ouvrage tristesse et impression de fermeture. Cette description de
la vie dans ses méandres et sa complexité, ses plaisirs
et ses blessures, forme finalement un panorama sombre de ce qui s'est
passé dans cette fin de siècle. Marqués par leur
culpabilité et hantés par les souvenirs du
passé, certains ne seront plus que des handicapés de la
vie. Le meilleur se situe dans ce que King a
raconté avec son coeur, plutôt qu'avec des combinaisons
à intentions littéraires douteuses; dans ce qu'il n'a
pas calculé, dans ce qu'il a écrit en étant
lui-même, au lieu de succomber à ses démons
familiers et de tomber dans l'artifice. Ce livre est marqué
par un grand amour, une compassion bienveillante envers les hommes.
Même Malenfant le bien nommé, qui perturbe la
scolarité de ses condisciples et en conduit un grand nombre au
ratage de leurs études, le tueur de la vieille muma-san, est humanisé en tant que suppôt du mal, et
fait pitié plutôt qu'horreur. Il ne se
révèle vraiment maléfique qu'au Vietnam quand,
vociférant à son habitude et tenant les autres sous son
emprise trouble, il se montre sous son vrai visage, un assassin et un
prédateur sans scrupules, parmi des compagnons d'armes qui,
s'ils en réchappent, sont promis à un sombre avenir :
"C'était ainsi que
s'achevaient réellement les guerres, se dit Dieffenbaker; non
pas à la table des pourparlers d'armistice, mais dans les
pavillons des cancéreux, ou dans les cafétérias
des entreprises, quand ce n'était pas au milieu d'un
embouteillage [où vient de mourir Sully d'une crise
cardiaque]. Les guerres mouraient par petits fragments
minuscules, tombant un à un comme disparaît un souvenir,
se perdant un à un comme l'écho s'éteint dans le
labyrinthe des collines. À la fin, même la guerre
hissait le drapeau blanc. Il l'espérait, du moins. Il
espérait qu'à la fin, même la guerre se rendait."
(536)
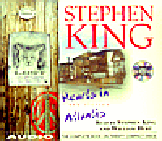 CONCLUSION : La fin de l'Atlantide.
CONCLUSION : La fin de l'Atlantide.
1. La position de
King.
Après avoir participé
aux luttes politiques et sociales de son temps, qui ont marqué
ce descendant de républicains, devenu hostile au conservatisme
et à l'étroitesse d'esprit de ce parti, King a
souvent critiqué dans ses oeuvres l'autorité, les
gouvernements, les pouvoirs, les institutions, voire les groupes de
pression. Il est l'un des écrivains les plus lus de son temps
et l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il n'a pas
plus d'influence sur son époque dans le domaine politique.
King vit une autre époque que celle des
Zola et des Aragon,
même des Gide et des
Mauriac, l'époque du grand silence des
intellectuels. Dans une civilisation de masse, individuellement on
peut se dévouer ou s'enrichir, méditer ou se
singulariser, mais on ne peut certainement pas bâtir une oeuvre
héroïque en changeant - ou en essayant de changer son
temps, comme l'ont pu le faire dans le passé Malraux ou Hemingway.
Il faut rattacher l'attitude de King à
l'égard du Vietnam à celle de sa position politique
fondamentale. King donne l'impression de fuir l'engagement direct et
de trouver dans son oeuvre un exutoire aux tensions qu'il a
accumulées pendant sa jeunesse. Exutoire, parce que
l'écriture le libère de ses tensions. Attitude
politique plus passive qu'active. King n'a pas, en
son temps, la voix d'un Arthur Miller ou d'un
Norman Mailer 36 durant son époque.
King se limite à une sorte de morale de la
Croix-Rouge, caractéristique de notre époque qui a
perdu sa foi au changement positif et ses
héros37. Confrontation permanente dans l'oeuvre de
King, des hommes de bonne volonté, qui luttent contre
des forces destructrices - dont ils ne sortent pas toujours
vainqueurs -, voient avec lucidité le monde qui les entoure et
le mal qui les environne. Pour les meilleurs d'entre eux, cette
confrontation débouche sur une révolte contre le
désordre établi. Des gens simples ou discrets, qui ont
un fond moral solide, du réalisme et la tête sur les
épaules, qui font tranquillement leur boulot sans
piétiner le voisin, et qui ne comprennent pas pourquoi des
choses vont de travers.
Leur morale est agissante,
insérée dans la vie quotidienne, celle de l'individu et
de son entourage, mais elle ne prétend pas changer
fondamentalement le monde. King a
gardé de l'utilisation de la violence contre la guerre du
Vietnam dans se jeunesse une réserve certaine. Dans
Le
Fléau, l'utilisation de la
violence contre un adversaire destructeur conserve son
caractère d'effraction provisoire à la règle.
Elle est toujours consciente du risque pour la conscience de se
perdre38 sans le sentiment élevé de ce qui est
moralement dû à la collectivité. D'autant plus
que ce qui est dû n'est pas théorique, mais qu'il faut
l'inventer dans la difficulté et l'angoisse pour vaincre la
malfaisance du moment, court instant où son utilisation est
appelée par l'excès d'injustice subi, et impossible
à éviter. Elle conserve un caractère douteux et
malsain, elle est envisagée avec beaucoup de scrupules et
acceptée seulement par nécessité. Sa seule
justification sera qu'elle obéira non à une doctrine ou
la Raison d'État, mais aux valeurs humaines et aux
solidarités qui l'expriment.
On peut comprendre ainsi pourquoi il
n'y a pas, dans l'oeuvre de King, de
déclaration fracassante contre la guerre du Vietnam, ou les
autres conflits qui ont suivi. Il n'y a pas, chez lui, un état
d'esprit propice à la rupture avec les institutions
présentes. Ses valeurs sont des valeurs traditionnelles,
proches de ce qu'on appellerait en France la mentalité
«chrétien de gauche» : croyance aux valeurs
démocratiques, à la possibilité pour les hommes
de construire leur avenir, en défendant le bien, la
vérité, la fidélité39. Une sorte d'idéalisme qui postule que
si l'homme est souvent mauvais, il n'est jamais totalement perdu, et
qu'il n'y a qu'à attendre que la petite flamme de l'humain se
ranime quelque part...
Dans le fracas médiatique,
King ne tient manifestement pas à ajouter sa voix à
celle des politiciens. La littérature lui suffit. Dans son
essai Danse
Macabre 40, il écrit : "Ce n'est pas une danse de mort, après
tout. (...) C'est
une danse des rêves. C'est une façon de réveiller
l'enfant qui sommeille en vous, un enfant qui n'est pas mort mais qui
dort profondément. Si l'histoire d'horreur est une
répétition de de notre mort, alors sa morale stricte en
fait également une réaffirmation de la vie, de la bonne
volonté et tout simplement de l'imagination - qui conduit vers
l'infini." On ne saurait
mieux dire les limites de ces prises de conscience des insuffisances
ou des tares de notre société. Les malheurs et les
dangers de notre société sont là : mais par la
distanciation de l'écriture et de la lecture, on peut
momentanément s'en évader, et somme toute - est-ce bien
regrettable ? - les supporter. La foi en la bonne volonté des
hommes fera le reste. Sorte d'anesthésie cathartique ? Sa
révolte culturelle et sociale, modérée dans son
expression, est peu susceptible de déboucher un jour sur un
mouvement de contestation fondamentale et de remise en ordre de nos
sociétés. La crise de conscience est parfois
aiguë, mais l'expression politique manque de cohérence,
de continuité, et les possibilités d'action sont bien
faibles41 ...
2. Les sentiments ds
lecteurs étudiants.
2. L'état d'esprit des jeunes
lecteurs universitaires.
Il semble d'ailleurs que la position des jeunes étudiants des
années soixante ne soit plus vraiment comprise par leurs
cadets. Pour la génération des adolescents
attirés, comme King, par des
études universitaires, l'absence d'engagement était
impensable : on était contre la guerre (la plupart), ou pour
(une minorité). De toute façon, les étudiants
étaient inévitablement amenés à prendre
position. On doit bien constater que, sauf pour des problèmes
très personnels, et, pour être brutal, très
égoïstes, les grandes causes ne mobilisent plus les
étudiants. Même quand ils ont conscience vaguement que
quelque chose pourrait être fait pour changer ce qui ne va pas
politiquement, ils ne protestent pas et ne descendent plus dans la
rue. Ils ne sont pas culpabilisés par leur rejet des
«grandes causes». Ils n'en ont pas le temps! Le temps libre
est occupé à se «défouler», et,
d'après certaines réactions d'étudiants
français que j'ai pu connaître, ils ne
s'intéressent qu'aux deux premières nouvelles de
Coeurs perdus en
Atlantide. La façon dont
s'amusaient les étudiants d'il y a trente ans les
intéresse plus que les considérations politiques de
l'époque. D'ailleurs, la quasi-totalité des
étudiants américains lisent peu les journaux, et
rarement des romans. Sauf pour les étudiants en lettres, bien
obligés de le faire, les autres ne lisent que quand ils ont
intérêt à porter leurs lectures sur leurs C.V.
Passer des heures autour d'une table à bavarder et à
refaire le monde leur est devenu totalement étranger. Les
seules discussions qu'ils connaissent sont celles qui se passent dans
le cadre des cours : en bref, discuter sur ordre... La plupart des
jeunes Américains n'éprouvent nulle détresse
devant les grandes misères du monde, et même devant la
détresse de certains groupes sociaux aux USA, qui vivent dans
le dénuement alors que l'abondance règne autour d'eux.
Leur seul projet est de se faire une place à tout prix au
soleil. Et, autant que possible, être de ceux qui, dans la
couche supérieure de la société, creusent
l'écart avec les classes défavorisées.
Alors que la génération des années 60
s'était en partie construite par sa lutte pour s'affranchir de
certaines contraintes, les étudiants actuels n'ont pas
à se battre pour s'émanciper d'un passé qui leur
pèse. Ils ne se considèrent pas comme les fils d'une
génération perdue, et les hippies, les beatniks, le
"flower power"1 ou Kérouac
leur paraissent du folklore. Élevés dans une
société où tout leur est donné, ils n'ont
plus à s'émanciper du passé. Ils ne sentent plus
leur monde comme source d'aliénation. Ils ont grandi dans une
société où la contre-culture des années
soixante a été absorbée dans la culture de
masse, et plus rien ne les étonne. Alors que leurs parents ou
grands-parents s'intéressent encore aux Beattles et ont gardé dans un coin le portrait de
Che Guevara, ils ont perdu les barrières mentales
qui opposaient l'ordre établi et les rebelles,
l'«establisment» et l'«underground» subversif. Le
monde ne leur paraît plus ni absurde, ni à changer. Il
est à prendre... Travailler dur, gagner beaucoup d'argent, se
comporter légalement et suivant le code du «politiquement
correct», faire un peu de bénévolat, de
préférence par des dons, là se limitent leurs
ambitions. Les anciens avaient été marqués par
des guerres qui les avaient meurtris, la deuxième guerre
mondiale, la Corée, dont on ne parle plus jamais. Des morts
pour la patrie en quantité. Depuis la fin de la guerre du
Vietnam, les dirigeants se gardent de tous les conflits où la
mort d'homme est possible, et préfèrent agir, pour
défendre leurs intérêts, avec des moyens
«propres», ou par des groupes étrangers
interposés et exécutant contre dollars... La guerre du
Vietnam a ainsi créé, par loes traumatismes
causés, des conditions belligérantes nouvelles, et les
jeunes générations n'ont jamais connu cette situation
de la peur au ventre devant l'ennemi qui a tant marqué la
génération des guerres
antérieures.2
Dès lors, peut-on être aussi sévère que
King à l'égard de sa génération? Son
comportement ne vient-il pas en grande partie de ce qu'elle ne se
reconnaît plus dans le monde actuel? Ce qu'elle souhaitait a
été obtenu. On voit le résultat : plus de
conflits ouverts, plus de grands combats, une vie à la fois
intense dans le travail et idéologiquement molle. Où on
apprend davantage la quête frénétique de l'argent
que la morale de l'accomplissement et de la réalisation de
soi-même... Si cette philosophie a encore un
sens.3
Roland Ernould Armentières
©
mai 2001
 Notes :
Notes :
26 Le mot Vietnam a de nombreuses graphies.
Personnellement, j'utilise la plus simple, mais je reprends celle des
textes quand elle est différente. Idem pour les autres noms
composés.
27 Réflexion curieuse et surprenante par son
nationalisme, qui suppose que King aurait souhaité que Dieu
soit du côté des USA, comme le réclament chaque
jour les écoliers américains...
28 Le coup de griffe ordinaire, que King ne rate
jamais!
29 Moïse sur le Mont Horel, voilant sa face pour la
protéger de l'ardeur du buisson ardent, apparence choisie par
la divinité pour se manifester, demande le nom de son
interlocuteur pour le signifier à son peuple. La
réponse a fait le bonheur d'exégètes
innombrables, «èhyèh aser
èhyèh»: "Dieu dit à Moïse : «Je suis qui Je
suis». Il dit : «Tu parleras ainsi aux fils d'Israël;
Je Suis m'a envoyé vers vous»" .
Les Hébreux diront naturellement : Il «Est», soit en
hébreu yahavèh,
ou Yahvé, pour désigner Dieu. Avant déformation,
«Est» désigne donc Dieu.
30 "Le palais des
chattes", note du traducteur
(448).
Sens sexuel.
31 Dans cette forme d'hystérie dite
«traumatique», les conflits étaient latents et
préexistaient au choc émotionnel (scène de
danger grave, accident, guerre, catastrophe collective). Cette
situation est associée dorénavant au trouble psychique
et antérieur, et se manifeste désormais dans une
situation de conversion. Revoir plus haut les réflexions qu'il
se fait en regardant sa citation : "Il a sauvé la vie de Sullivan sur la piste, dans
les environs du patelin. C'est ce que proclame la citation
accompagnant la Silver Star, c'est ce qu'ont déclaré
les hommes ayant survécu à Dong Ha, et bien plus
important encore, c'est ce qu'a affirmé Sullivan
lui-même." Voir le
classique : Sigmund Freud, Cinq psychanalyses, PUF, 1954; Introduction à la psychanalyse, Payot, 1965.
32 Plusieurs scènes du Vietnam de ce genre figurent
dans cette nouvelle, trop longues à reproduire.
33 "Tenue des
pensionnaires de lupanars."
(N.d.T.)
34 Défoliant très toxique massivement
employé par l'Armée américaine au
Viét-nam (N.d.T) Le défoliant avait été
employé pour supprimer la végétation de la
jungle et rendre les déplacements de l'ennemi difficiles.
24.000 tonnes de défoliants ont été
officiellement déversés par avion et
hélicoptères sur 1.700.000 hectares. Des procès
ont été intentés par les vétérans
contre les firmes Monsonto et Dow.
35 George Beahm, The Stephen King Story, 67.
36 Qui, outre leurs positions respectives contre la
hiérarchie militaire ou l'asservissement aux biens
matériels, furent parmi les rares à dénoncer la
chasse aux sorcières déclenchée par Mac
Carthy.
37 Qu'on trouve encore dans des pays comme le
Moyen-Orient, par exemple, avec ses terroristes qui ont le
comportement des kamikazes japonais de la dernière guerre
mondiale.
38 Voir l'étude
: Stephen King
politique, LES ALÉAS D'UNE
DÉMOCRATIE,
2ème partie.
39 "I view the
world with what is essentially an old-fashioned frontier vision. I
believe that people can master their own destiny and confront and
overcome tremendous odds. I'm convinced that there exist absolute
values of good and evil warring for supremacy in this universe -
which is, of course, a basically religious viewpoint. And
(...) I also believe that the traditional values of
family, fidelity, and personal honor to have not all drowned and
dissolved in the trendy California hot tub of the "me" generation.
That put me at odds with what is essentially an urban and liberal
sensibility that equates all change with progress and wants to
destroy all conventions, in literature as well as in
society.", dans la
célèbre Playboy
Interview, Eric Norden, juin
1983, cité par George Beahm, The Stephen King Companion, 67.
40 1981, Pages
Noires , op.cit. ,
216.
41 Elles se manifestent au plus par des participations et
des oeuvres de bienfaisance, nombreuses il est vrai. La seule
participation vigoureuse de King a été contre la
censure littéraire que des autorités voulaient
instituer dans son État, qu'il a combattu avec vigueur, mais
qui le menaçait directement...
42 Le mot Vietnam a de nombreuses graphies.
Personnellement, j'utilise la plus simple, mais je reprends celle des
textes quand elle est différente. Idem pour les autres noms
composés, Vietcong ou autres.
1 À dater de 1966, avec Abbie Hoffman et Menu
Bubn. La première partie de cette étude :
KING CONTRE LA GUERRE DU
VIETNAM
: l'homme et le
conflit., est à lire pour
comprendre ce développement.
2 La guerre contre l'Irak des années 90 s'est
déroulée comme un véritable show
médiatique, et les spectateurs ont été plus
sensibles aux prodigieux moyens techniques déployés
qu'aux problèmes humains. la guerre s'est d'ailleurs
terminée dès qu'elle entraînait l'occupation de
l'Irak, et que les généraux risquaient de perdre des
vies humaines dans la guerre des rues ou la guérilla.
3 Je renvoie mes lecteurs à la formule de Gide qui
figure en exergue de
ce site.
 ce texte a
été publié dans ma Revue trimestrielle
différentes saisons
saison # 12 -
été 2001.
ce texte a
été publié dans ma Revue trimestrielle
différentes saisons
saison # 12 -
été 2001.
 ..
voir 1a 1ère
partie :
STEPHEN KING, PETER
STRAUB ET LA GUERRE DU VIETNAM:
.KING CONTRE LA GUERRE DU VIETNAM.
..
voir 1a 1ère
partie :
STEPHEN KING, PETER
STRAUB ET LA GUERRE DU VIETNAM:
.KING CONTRE LA GUERRE DU VIETNAM.
 ..
..
|
AUTRES TEXTES
CONCERNANT LA JEUNESSE DE KING :
Rage,
UNE
OEUVRE DE JEUNESSE ANNONCIATRICE
En 1966, King achève
sa terminale à la High School de Lisbon Falls,
près de Durham. Il a 18 ans. Depuis le printemps, il
a commencé à écrire le premier de ses
romans publiés, Getting it on . Quand on analyse la composition et
le contenu du roman sans se soucier de l'intrigue et de son
évolution, on voit apparaître bon nombre de
thèmes qui continueront à inspirer King dans
ses oeuvres jusqu'à ce jour. C'est un recensement de
ces thèmes qui est l'objet de cette étude. Ils
se rapportent successivement à l'individu,
l'éducation, la collectivité, la culture et
divers autres aspects de moindre importance. Il serait
futile de prétendre que Getting it on contient en condensé l'oeuvre
à venir de King. Mais il porte en son sein
d'intéressants germes qui grandiront et feront
l'objet, avec des fortunes diverses, de
développements et de situations variées.
À ce titre, au-delà de la faiblesse relative
de ce roman d'un jeune auteur, on peut considérer
qu'il a constitué pour King une première
occasion de mettre au point une technique qui consiste
à mettre une partie de soi dans une oeuvre qui se
veut entièrement tournée vers
l'imaginaire.
Les premiers romans
: RAGE, RÉVOLTE et
DÉSESPOIR.
Les premiers romans que King
a écrits entre 19 et 24 ans Rage et Running Man présentent un grand intérêt
pour la formation de sa sensibilité et pour la
compréhension de la genèse de sa pensée
sociale. Le rapprochement de ces deux oeuvres paraît
donc légitime et le but de cette étude est de
poser des jalons pour l'analyse du passage d'un King
étudiant à un King chargé de famille,
dont la vie n'est pas facile. Charlie a vécu une
scolarité lycéenne terne et peu heureuse, puis
a connu le bouillonnement universitaire de la fin des
années soixante. Ben est passé d'une
indifférence vis-à-vis du social (comme
Charlie) à une prise de conscience plus grande des
réalités politiques du moment. Les situations
sont étudiées sous un éclairage
littéraire en les rapportant au vécu de King
adolescent. S'agit-il d'une révolte réelle qui
a existé chez King? En famille, au lycée ou
à l'université? Jusqu'où est-elle
allée?
(King vient de demander aux
éditions Penguin de ne pas refaire de retirage de son
roman Rage: raison
invoquée: le massacre de Littleton. Infos)
|


 Contenu de ce site
Stephen King et littératures de l'imaginaire :
Contenu de ce site
Stephen King et littératures de l'imaginaire :
 .. du site Imaginaire
.. du site Imaginaire
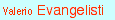 .. ... .
.. ... .
 .. du site
Stephen King
.. du site
Stephen King